12/10/2011
Des vies d'oiseaux – Véronique Ovaldé [2011]
 « Mon Dieu il me semble bien être vivante dans ma tombe. » (p. 43)
« Mon Dieu il me semble bien être vivante dans ma tombe. » (p. 43)
Vida Izzara est une femme un peu perdue, qui ne sait pas où est passé sa vie. Originaire d'Irogoy, la "terre d'en bas", zone pouilleuse et désolée, peuplée de créatures aux visages de chien, elle s'est hissée par son mariage avec le riche Gustavo jusqu'à la "terre d'en haut", Villanueva, et ses somptueuses maisons huppées asphyxiantes. Dans sa cage dorée, Vida contemple la vacuité de son existence et s'étiole peu à peu, surtout depuis que sa fille unique, Paloma, s'est enfuie avec Adolfo, le jardinier. Paloma et Adolfo squattent les maisons inoccupées de la colline Dollars, une manière de narguer leurs vies antérieures. Mais le lieutenant Taïbo, flic placide et mélancolique qui enquête sur ces étranges clandestins, rencontre Vida et met ses pas dans les siens, telle une ombre de plus en plus familière et sensuelle...
On retrouve dans ce roman le phrasé si particulier, un peu déconcertant, de Véronique Ovaldé : une écriture pleine d'étrangeté, des phrases amples dans lesquelles s'insèrent de multiples parenthèses, un style parfois "flou"... Le tout donne une impression d'étrangeté et de flottement entre rêve et réalité.
On retrouve aussi une certaine typologie de personnages, des caractères féminins volontaires, animés par leur quête d'un idéal : une mère, une fille, et leurs choix de vie. Mère et fille, chacune à sa manière, par la grâce d'un nouvel amour, est conduite à se défaire de ses anciens liens (conjugaux, familiaux, sociaux) pour éprouver sa liberté d'exister. Mais une fois de plus, comme dans le précédent roman de Véronique Ovaldé, Ce que je sais de Vera Candida, cet affranchissement n'est finalement atteignable qu'avec le secours d'un homme, ce qui est tout de même assez restrictif comme moyen d'émancipation !
On retrouve enfin les thèmes récurrents chers à Véroniques Ovaldé : lutte des classes, lutte des sexes, lutte des générations, transmission de mère à fille, soumission volontaire et conquête de la liberté.
Des vies d'oiseaux retisse donc, mais en mode mineur, des motifs déjà rencontrés dans Ce que je sais de Vera Candida. C'est roman tout aussi sombre et dur que le précédent, mais bien moins fantaisiste, et qui laisse une impression de désenchantement, malgré le final plutôt positif.
______________________________
 Véronique Ovaldé, Des vies d'oiseaux, éd. de l'Olivier, 2011, 235 pages, 19 €.
Véronique Ovaldé, Des vies d'oiseaux, éd. de l'Olivier, 2011, 235 pages, 19 €.
Du même auteur : Ce que je sais de Vera Candida
13:55 | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : véronique ovaldé, relations mère-fille, émancipation, amérique du sud, fugue
07/09/2011
Ce que je sais de Vera Candida – Véronique Ovaldé [2009]
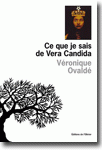 Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire... Rose, prostituée puis pêcheuse de poisson volant, sa fille Violette, jolie et candide personne aimant un peu trop le ratafia, sa petite-fille Vera Candida, au sourire rare, que Rose élèvera pour palier aux déficiences de Violette, et enfin son arrière-petite-fille, Monica Rose, petite fée espiègle. Rose, Violette, Vera Candida, Monica Rose... Cette lignée de femmes-amazones éprises de liberté semble vouée au même destin : enfanter seule une fille et ne jamais pouvoir révéler le nom du père. Fatalité ? Déterminisme familial ? A 15 ans et enceinte d'un viol, Vera Candida tente de rompre le cercle vicieux en fuyant la pauvreté de son île natale pour le continent. Là, elle rencontre un journaliste idéaliste, Itxaga, qui tombe éperdument amoureux d'elle...
Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire... Rose, prostituée puis pêcheuse de poisson volant, sa fille Violette, jolie et candide personne aimant un peu trop le ratafia, sa petite-fille Vera Candida, au sourire rare, que Rose élèvera pour palier aux déficiences de Violette, et enfin son arrière-petite-fille, Monica Rose, petite fée espiègle. Rose, Violette, Vera Candida, Monica Rose... Cette lignée de femmes-amazones éprises de liberté semble vouée au même destin : enfanter seule une fille et ne jamais pouvoir révéler le nom du père. Fatalité ? Déterminisme familial ? A 15 ans et enceinte d'un viol, Vera Candida tente de rompre le cercle vicieux en fuyant la pauvreté de son île natale pour le continent. Là, elle rencontre un journaliste idéaliste, Itxaga, qui tombe éperdument amoureux d'elle...
Ce que je sais de Vera Candida est un roman à la fois tragique et fantaisiste. Tragique par les sujets abordés (le manque d'amour, la fatalité, le viol, l'inceste) et fantaisiste par son style joyeusement bondissant, plein de malice et d'images inattendues. C'est un roman qui fait la part belle aux femmes, des femmes à la fois fortes et fragiles, fières et soumises, courageuses, éprises d'absolu, gonflées d'orgueil salutaire, et qui trouvent la force de s'élever face à l'intransigeance de la condition féminine. C'est un roman qui parle de transmission de mère à fille, de soumission volontaire, d'affranchissement et de liberté.
C'est un roman qui avait décidément tout pour me plaire... mais qui pourtant ne m'a pas emporté. Même si je reconnais l'originalité du style, j'y suis restée totalement insensible, pas réceptive du tout et même un peu lassée par "trop" d'effets de style qui lui confèrent un aspect "maniéré". Quant au récit en lui-même, même s'il traite de thèmes qui me sont chers (l'émancipation des femmes notamment), j'ai trouvé que les personnages principaux, tous des femmes donc, restaient assez "froids" et trop passifs, acceptant comme une fatalité leur destin.
Au final, ce roman qui aurait pu être le récit enchanté d'une émancipation m'a au contraire laissé un goût amer de désenchantement... et d'ennui.
______________________________
 Véronique Ovaldé, Ce que je sais de Vera Candida, éd. de l'Olivier, 2009, 292 pages, 19€.
Véronique Ovaldé, Ce que je sais de Vera Candida, éd. de l'Olivier, 2009, 292 pages, 19€.
Du même auteur : Des vies d'oiseaux
16:20 | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : véronique ovaldé, relations mère-fille, viol, inceste, émancipation, amérique du sud
25/08/2010
La ballade d'Iza – Magda Szabó [1963]
Pour mon séjour à Budapest, j'ai cherché à emporter une lecture de circonstance. Après quelques recherches dans les rayonnages de ma médiathèque, j'ai opté pour un ouvrage de Magda Szabó, une grande dame des lettres hongroises encore méconnue en France malgré son Prix Femina étranger 2003 pour son roman La Porte. Ce n'est toutefois pas ce livre-là que j'ai emporté, mais La ballade d'Iza :
 Dans les années 1960, dans sa maison de la Grande Plaine hongroise, Mme Szöcs attend d'aller à l’hopital : son mari est en train de mourir. Sur place, Vince ne la reconnaît pas, et sa dernière phrase est destinée à Iza, leur fille bien-aimée. Une fois son père enterré, Iza emmène sa mère vivre avec elle dans son appartement de Budapest. Elle a tout décidé, fait le tri entre meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé la chambre qui doit accueillir sa mère, sans demander à la vieille dame (qui pourra « enfin se reposer ») ni son avis ni ses envies. Mais peu à peu la fragile vieille dame se pétrifie dans la non-existence qui lui est ainsi offerte, jusqu'au jour où elle décide de retourner dans son village afin de faire élever une stèle sur la tombe de son mari...
Dans les années 1960, dans sa maison de la Grande Plaine hongroise, Mme Szöcs attend d'aller à l’hopital : son mari est en train de mourir. Sur place, Vince ne la reconnaît pas, et sa dernière phrase est destinée à Iza, leur fille bien-aimée. Une fois son père enterré, Iza emmène sa mère vivre avec elle dans son appartement de Budapest. Elle a tout décidé, fait le tri entre meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé la chambre qui doit accueillir sa mère, sans demander à la vieille dame (qui pourra « enfin se reposer ») ni son avis ni ses envies. Mais peu à peu la fragile vieille dame se pétrifie dans la non-existence qui lui est ainsi offerte, jusqu'au jour où elle décide de retourner dans son village afin de faire élever une stèle sur la tombe de son mari...
La grande qualité de ce roman tient dans ses personnages, tous dépeints avec finesse et pudeur, sans jugement de valeur. Et en tout premier lieu le vieux Vince, un homme intègre, un ancien magistrat longtemps écarté de son poste pour avoir prononcé un jugement qui avait déplu au régime. Magda Szabó en brosse un portrait magnifique ! Tout aussi attendrissante, son épouse est une petite bonne femme effacée, une bonne fée discrète, économe, qui dans l'adversité a fait preuve d'une détermination pugnace pour maintenir sa famille à flot. A la mort de Vince, elle s'agrippe tout autant à son vieux cabas usé qu'à ses souvenirs, mais quand elle doit quitter son village pour s'installer à Budapest, dans le petit appartement d'Iza, c'est un cruel déracinement que lui impose sa fille. Dans cette ville froide, la vieille dame désœuvrée se sent terriblement seule, comme exilée, sans jamais s'en ouvrir à sa fille Iza qu'elle ne veut en aucune façon inquiéter, ou contrarier, et qui s'échine à rendre sa mère heureuse malgré elle. Enfin donc Iza, qui certes adore ses parents mais qui, dans sa logique de contrôle absolu, et persuadée de faire au mieux pour le bien-être de sa mère, ne se rend pas compte de la détresse de cette dernière. Quant aux personnages secondaires (Antal, l'ex-mari d'Iza ; Lidia l'infirmière ; Domokos, l'amant d'Iza), ils sont tout aussi remarquables.
Mais le cœur de l'intrigue reste les relations entre un père, une mère, une fille. Vince, Etelka, Iza, trois êtres qui s'aiment passionnément sans savoir s'aimer "correctement". Entre ces trois êtres, Magda Szabó tisse une relation subtile, faite de tendresse infinie, de pudeur, de non-dit, et bien souvent d'incompréhension. Ou comment, parfois, pourtant pétri de bonnes intentions, on en vient à mal-aimé ceux que l'on aime le plus... Un roman qui interroge sur notre capacité (ou incapacité) à rendre l'autre heureux, un roman sur la difficulté d'aimer.
C'est beau et touchant, et pudique, d'une finesse psychologique rare, tenu par une construction et un rythme impeccables, et une écriture précise, sobre, délicate, intime et mélancolique. Une merveille dont il serait grand dommage de se passer !
______________________________
 Magda Szabó, La ballade d'Iza (Pilátus), traduit du hongrois par Tibor Tardös, éd. Viviane Hamy, 2005 (1963), 261 pages, 21,50 €.
Magda Szabó, La ballade d'Iza (Pilátus), traduit du hongrois par Tibor Tardös, éd. Viviane Hamy, 2005 (1963), 261 pages, 21,50 €.
09:26 | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : la ballade d'iza, magda szabó, littérature hongroise, hongrie, budapest, famille, relations mère-fille
25/06/2010
Crépuscule irlandais – Edna O'Brien [2006]
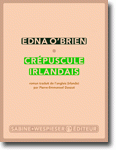 Dans ce roman l'auteur explore les sentiments des femmes ; elle s'intéresse en particulier à l'amour maternel en disséquant les rapports tumultueux entre Eleanora et sa mère Dilly, entre amour incommensurable et déchirures multiples. « […] souviens-toi, l'amour c'est que des sornettes, le seul amour véritable c'est entre mère et enfant. » Ces mots, ce sont ceux de Dilly, ceux qu'elle a écrits à sa fille chérie, devenue petit à petit si distante, presque inaccessible.
Dans ce roman l'auteur explore les sentiments des femmes ; elle s'intéresse en particulier à l'amour maternel en disséquant les rapports tumultueux entre Eleanora et sa mère Dilly, entre amour incommensurable et déchirures multiples. « […] souviens-toi, l'amour c'est que des sornettes, le seul amour véritable c'est entre mère et enfant. » Ces mots, ce sont ceux de Dilly, ceux qu'elle a écrits à sa fille chérie, devenue petit à petit si distante, presque inaccessible.
A l'ouverture du roman, Dilly est à l'hôpital : âgée et malade, elle est en attente d'un diagnostic et d'une ultime visite de sa fille adorée qui tarde à venir à son chevet. Mais si le roman débute ainsi sur la fin de vie de Dilly, bien vite il nous entraîne dans ses souvenirs et nous narre sa vie, et celle de sa fille. Découvrir la suite...
04/01/2010
La pluie, avant qu'elle tombe – Jonathan Coe [2007]
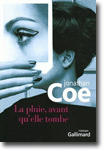 Rosamond vient de mourir. A sa nièce Gill, elle lègue la mission de retrouver Imogen afin de lui remettre une vingtaine de photographies ainsi qu'une série de cassettes audio. Ne retrouvant pas Imogen, Gill va écouter les cassettes sur lesquelles sa tante raconte, à partir des photographies, et des années 40 à aujourd'hui, son histoire familiale. L'histoire de quatre générations de femmes maltraitées par leur mère : Ivy qui préféra son caniche Bonaparte à sa fille Beatrix, laquelle vit dans sa fille Thea la source de tous ses errements, laquelle fut contrainte de confier sa petite Imogen, aveugle, à une famille d'adoption. Rosamond dévoile ainsi, cliché après cliché, anecdotes après souvenirs, l'envers des sourires affichés : des mères égarées, des filles perdues, des femmes au-delà de toute consolation, et le désamour maternel dont on ne guérit jamais.
Rosamond vient de mourir. A sa nièce Gill, elle lègue la mission de retrouver Imogen afin de lui remettre une vingtaine de photographies ainsi qu'une série de cassettes audio. Ne retrouvant pas Imogen, Gill va écouter les cassettes sur lesquelles sa tante raconte, à partir des photographies, et des années 40 à aujourd'hui, son histoire familiale. L'histoire de quatre générations de femmes maltraitées par leur mère : Ivy qui préféra son caniche Bonaparte à sa fille Beatrix, laquelle vit dans sa fille Thea la source de tous ses errements, laquelle fut contrainte de confier sa petite Imogen, aveugle, à une famille d'adoption. Rosamond dévoile ainsi, cliché après cliché, anecdotes après souvenirs, l'envers des sourires affichés : des mères égarées, des filles perdues, des femmes au-delà de toute consolation, et le désamour maternel dont on ne guérit jamais.
Je connaissais Jonathan Coe pour ses romans réalistes et satiriques, critiques sociales ou politiques relevées d'un humour caustique empreint de cynisme. Des romans à la construction complexe, avec une intrigue sophistiquée, un décor social très détaillé, une multiplicité de personnages liés les uns aux autres par un écheveau dense de relations. Avec La pluie, avant qu'elle tombe, il change radicalement de registre. Il propose ici un roman court, à la construction simple (20 photos, 20 chapitres), au style épuré. Il nous livre un mélodrame méditatif, une épopée intimiste, le portrait touchant d'une lignée de femmes marquées par le désamour et qui, de mères à filles, semblent se léguer le malheur en héritage.
Les critiques ont presque unanimement salué la "virtuosité" de ce livre "poignant" : j'ose à peine écrire que j'ai été un peu déçue... Certes, Jonathan Coe est un bon écrivain, ses personnages sont dessinés avec finesse, mais le procédé narratif, très rigide, cette succession de photos dont la description structure le roman, m'est apparu comme un "exercice de style" qui alourdit le récit. De plus la révélation finale est un peu décevante puisqu'on la devine en amont. Et alors que cette histoire est de bout en bout tragique, elle ne m'a finalement que peu touchée. Peut-être trop "bluette" ? Et à aucun moment je n'ai retrouvé cet humour sarcastique que j'aime tant chez Coe...
Reste qu'il se dégage de cette histoire douce-amère une certaine atmosphère, mélancolique, désenchantée, une douceur sous la grisaille, presque confortable, et en même temps nimbée de chagrin. Le tout lié à une réflexion sur le temps qui passe, sur les occasions manquées : au fil de la narration, au fil des générations, se pose la question des hasards, de la destinée, des coïncidences, des drames à répétition. Hasard ou destin, qu'est-ce qui régit nos vies ? Le destin a-t-il un sens ou n'est-ce qu'une chimère, comme la pluie, avant qu'elle tombe : « Il faut qu'elle tombe, sinon ce n'est pas de la pluie », explique Rosamond à Thea, enfant. « Bien sûr que ça n'existe pas, elle a dit. C'est bien pour ça que c'est ma préférée. Une chose n'a pas besoin d'exister pour rendre les gens heureux, pas vrai ? »
______________________________
 Jonathan Coe, La pluie, avant qu'elle tombe (The rain before it falls), traduit de l'anglais par Jamila et Serge Chauvin, éd. Gallimard, coll. Du monde entier, 2009 (2007), 248 pages, 19,50 €.
Jonathan Coe, La pluie, avant qu'elle tombe (The rain before it falls), traduit de l'anglais par Jamila et Serge Chauvin, éd. Gallimard, coll. Du monde entier, 2009 (2007), 248 pages, 19,50 €.
Du même auteur : Les Nains de la Mort, Testament à l'anglaise & La Maison du sommeil.
























