17/01/2010
Car – Harry Crews [1972]





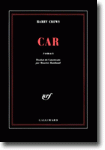 Herman a grandi dans la casse automobile de son père Easy avec son frère Mister, chargé de la presse à voiture, et sa sœur Junell, aux commandes de "Grosse Mama", la dépanneuse. Herman est le rêveur de la famille. Et Herman aime les voitures. Une en particulier, une superbe Ford Maverick rouge. Il en est fou. Au point de vouloir la posséder totalement, complètement. Au point de décider de la manger, morceau par morceau, du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Et comme notre histoire se déroule aux Etats-Unis, il ne faut pas longtemps pour qu'un businessman flaire le coup médiatique, mette en scène le spectacle (Herman en phénomène de foire, ingurgitant et "restituant" la Maverick à heure fixe devant un parterre de spectateurs hystériques), et bien vite la presse s'enflamme pour se défi d'un nouveau genre et la télé rapplique.
Herman a grandi dans la casse automobile de son père Easy avec son frère Mister, chargé de la presse à voiture, et sa sœur Junell, aux commandes de "Grosse Mama", la dépanneuse. Herman est le rêveur de la famille. Et Herman aime les voitures. Une en particulier, une superbe Ford Maverick rouge. Il en est fou. Au point de vouloir la posséder totalement, complètement. Au point de décider de la manger, morceau par morceau, du pare-chocs avant au pare-chocs arrière. Et comme notre histoire se déroule aux Etats-Unis, il ne faut pas longtemps pour qu'un businessman flaire le coup médiatique, mette en scène le spectacle (Herman en phénomène de foire, ingurgitant et "restituant" la Maverick à heure fixe devant un parterre de spectateurs hystériques), et bien vite la presse s'enflamme pour se défi d'un nouveau genre et la télé rapplique.
« - Mais pour l'amour de Dieu, pourquoi ? Pourquoi faut-il que... que...
- Pourquoi faut-il que je... mange... une... voiture ? »
Herman articulait avec une extrême lenteur, comme s'il eut voulu savourer les mots. « Je peux te le dire. Partout où il y a des Américains, il y a des voitures. » Il s'interrompit de nouveau, puis ajouta lentement : « Et parce qu'il y a des voitures partout, je vais en manger une. »
La métaphore est limpide : satire de l'Amérique modèle de société de consommation dont l'automobile, symbole de puissance, de richesse et de liberté individuelle, est l'emblème ; et critique des médias. Hélas ! Une bonne idée ne suffit pas toujours à faire un livre, et ni le style ni l'histoire ne m'ont convaincu. J'ai toutefois aimé les personnages (j'ai toujours un faible pour les personnages déglingués), tous un peu paumés. Harry Crews a une vraie tendresse pour les personnages "en marge", les familles en perdition, les types fêlés, les tarés illuminés, les filles aguicheuses, les rebuts de l'american way of life. Face à cette bande de tordus magnifiques, les autres, les gens "normaux" (visages lisses, corps entretenus et portefeuilles garnis) paraissent alors bien pathétiques...
______________________________
 Harry Crews, Car, traduit de l'américain par Maurice Rambaud, éd. Gallimard, coll. Noire, 1996, 206 pages, 12,96 €.
Harry Crews, Car, traduit de l'américain par Maurice Rambaud, éd. Gallimard, coll. Noire, 1996, 206 pages, 12,96 €.
14:30 Publié dans => Challenge 100 ans de littérature américaine | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : car, harry crews, littérature américaine, etats-unis, voiture, télévision
11/01/2010
Le couperet – Donald Westlake [1997]





 Burke Devore, la cinquantaine, est cadre supérieur depuis vingt-cinq ans dans une usine de papier. Il a un joli pavillon, une femme au foyer, deux grands enfants et deux voitures. Petite vie tranquille, bien rangée, bien réglée, vie rêvée de la classe moyenne américaine, vie parfaite. Jusqu'au jour où... lui arrive ce qui n'arrive qu'aux autres : Burke Devore est licencié. « Pourquoi me suis-je fais virer, alors que la boîte est bénéficiaire et plus florissante que jamais ? La réponse est que notre absence rend l'entreprise encore plus puissante, les dividendes encore plus élevés, le retour sur investissement encore plus intéressant. »
Burke Devore, la cinquantaine, est cadre supérieur depuis vingt-cinq ans dans une usine de papier. Il a un joli pavillon, une femme au foyer, deux grands enfants et deux voitures. Petite vie tranquille, bien rangée, bien réglée, vie rêvée de la classe moyenne américaine, vie parfaite. Jusqu'au jour où... lui arrive ce qui n'arrive qu'aux autres : Burke Devore est licencié. « Pourquoi me suis-je fais virer, alors que la boîte est bénéficiaire et plus florissante que jamais ? La réponse est que notre absence rend l'entreprise encore plus puissante, les dividendes encore plus élevés, le retour sur investissement encore plus intéressant. »
« ll n'est pas un seul PDG qui n'ait commenté publiquement la vague de compressions de personnel qui balaie l'Amérique sans l'expliquer par une variation sur la même idée : "la fin justifie les moyens". La fin que j'accomplis, l'objectif, le but, est juste, incontestablement juste. Je veux m'occuper de ma famille ; je veux être un élément productif de la société ; je veux faire usage de mes compétences ; je veux travailler et gagner ma propre vie et ne pas être à la charge des contribuables. Les moyens de cette fin ont été difficiles, mais j'ai gardé les yeux rivés sur l'objectif. Comme les PDG, je n'ai rien à regretter. » Burke Devore décide donc d'appliquer à la lettre et jusqu'à l'absurde la méthode du libéralisme pour retrouver un emploi : éliminer la concurrence. Il va mettre ses compétences et sa force de travail à éliminer un à un ses concurrents. Oui, il les abat, l'un après l'autre, avec un vieux revolver ou avec un marteau ou avec sa voiture ou pire encore...
Alors, bien sûr, il y a du sang et quelques atrocités burlesques dans ce roman (certains mecs sont particulièrement coriaces à bousiller, faut dire), mais Westlake évoque aussi les conséquences désastreuses du chômage sur l'individu, le couple, la famille, le lien social en racontant le quotidien de cette famille touchée par la crise : on vend la seconde voiture, l'épouse trouve un boulot d'appoint, pas trop déshonorant, on n'invite plus les amis pour cacher sa déchéance... Et puis, il y a les dérapages fatidiques : le couple qui se déchire, le fils qui chaparde des CD-Rom... Et le bonheur se délite, peu à peu.
Je m'attendais à un livre loufoque sur fond de critique sociale mais, si la critique sociale est bien présente, l'humour, lui, est faussement joyeux, plutôt acide même. Sous des dehors comiques, le récit reste pessimiste, l'auteur aimant à ironiser sur l'humanité et son cynisme. C'est donc cruel, et absurde, mais le lecteur y croit et s'attache malgré tout à Burke, ce serial killer d'un nouveau genre, un mec sympa, fidèle, sincère, qui œuvre pour préserver sa famille, qui tue certes, mais par nécessité, presque par autodéfense, et n'y prend aucun plaisir. La narration du point de vue du criminel donne encore plus de force à cette histoire, le lecteur en venant à épouser son raisonnement et sa logique sans faille dans toute son horreur. La construction est minutieuse, implacable, jusqu'au dénouement, inéluctablement cynique. L'écriture, elle, est déconcertante de sècheresse (de spontanéité, diront les plus indulgents) : elle fait certes "vrai" mais aussi un peu pauvre tout de même...
Et j'en terminerai en citant juste la première phrase du roman « en fait, je n'ai jamais encore tué personne, assassiné quelqu'un, supprimé un autre être humain » qui préfigure à elle seule la suite des événements...
______________________________
 Donald Westlake, Le couperet (The Ax), traduit de l'américain par Mona de Pracontal, éd. Rivages, coll. Rivages thriller, 1998 (1997), 245 pages, 11,98 €.
Donald Westlake, Le couperet (The Ax), traduit de l'américain par Mona de Pracontal, éd. Rivages, coll. Rivages thriller, 1998 (1997), 245 pages, 11,98 €.
12:50 Publié dans => Challenge 100 ans de littérature américaine | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le couperet, donald westlake, polar, etats-unis, chômage, littérature américaine
05/12/2009
La route – Cormac McCarthy [2006]





 Cormac McCarthy revisite avec La route le roman d'anticipation post-apocalyptique. Il y propose une réflexion sur le devenir de l'homme, il y interroge aussi les thèmes de la filiation et de la transmission.
Cormac McCarthy revisite avec La route le roman d'anticipation post-apocalyptique. Il y propose une réflexion sur le devenir de l'homme, il y interroge aussi les thèmes de la filiation et de la transmission.
L'apocalypse a donc eu lieu. Le monde est dévasté, dépeuplé, couvert de cendres, et on ne sait rien des causes de ce cataclysme. Un père et son fils errent sur une route, marchent vers le Sud (sans doute les choses ne vont pas mieux là-bas, mais il y fait moins froid), inlassablement, en poussant devant eux un caddie rempli d'objets hétéroclites devant assurer leur survie : couvertures, conserves, eau, lampe... Ils ont froid, ils ont faim, ils ont peur. Ils sont sur leurs gardes, car le danger guette : l'humanité est retournée à l'état sauvage, à la barbarie, le monde est livré aux hordes de pilleurs, esclavagistes et anthropophages.
La route est avant tout un récit initiatique, un récit de transmission, de père à fils. Mais dans un monde sans Dieu, ni justice ou morale auxquels se raccrocher, et à l'heure où l'humanisme le plus primaire n'est plus qu'un souvenir, que faut-il inculquer à son enfant, au-delà du simple instinct de survie ? Un semblant de morale sans religion (le tabou, c'est manger l'autre), une vague foi en soi, en la vie, en l'esprit humain... Ainsi, quand l'enfant interroge son père, c'est uniquement pour vérifier s'ils sont bien, père et fils, "du côté des gentils", et non de celui des monstres.
On peut ainsi relever dans ce récit les obsessions et hantises de McCarthy déjà révélées dans son précédent roman, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme : la violence des hommes, le rude combat que se livrent en ce monde le Bien et le Mal, et la victoire de plus en plus manifeste de ce dernier.
Mais La Route s'offre aussi à lire comme un roman d'amour, cet amour qui unit l'adulte et l'enfant, cette folle tendresse du père qui s'escrime à préserver une braise d'innocence dans le cœur de son enfant, ce qui, peut-être, préserve l'homme de glisser vers la barbarie. Ce sentiment, McCarthy lui confère une intensité telle que les ténèbres alentours ne parviendront pas à l'étouffer et l'éteindre.
La route est un récit d'une lugubre beauté. Son style dépouillé, son austère lenteur, son rythme particulier et la scansion singulière de la phrase de McCarthy lui confèrent une grâce spécifique, funeste et envoûtante. Sous ses dehors désincarnés, La route est une histoire humaine et brûlante, de celles qui vous serrent à la gorge, de celles qui vous ébranlent, de celles qui vous dévastent.
« La route traversait un marécage desséché où des tuyaux de glace sortaient tout droits de la boue gelée, pareils à des formations dans une grotte. Les restes d'un ancien feu au bord de la route. Au-delà une longue levée de ciment. Un marais d'eau morte. Des arbres morts émergeant de l'eau grise auxquels s'accrochait une mousse de tourbière grise et fossile. Les soyeuses retombées de cendre contre la bordure. Il s'appuyait au ciment rugueux du parapet. Peut-être que dans la destruction du monde il serait enfin possible de voir comment il était fait. Les océans, les montagnes. L'accablant contre-spectacle des choses en train de cesser d'être. L'absolue désolation, hydropique et froidement temporelle. Le silence. »
« C'était encore plus dur qu'il ne l'aurait imaginé. Au bout d'une heure ils avaient peut-être parcouru un peu plus d'un kilomètre. Il fit halte et se retourna vers le petit. Il s'était arrêté et attendait.
Tu crois qu'on va mourir, c'est ça ?
J'sais pas.
On ne va pas mourir.
D'accord.
Mais tu ne me crois pas.
J'sais pas.
Pourquoi tu crois qu'on va mourir ?
J'sais pas.
Arrête de dire j'sais pas.
D'accord.
Pourquoi tu crois qu'on va mourir ?
On n'a rien à manger.
On va trouver quelque chose.
D'accord.
Combien de temps tu crois qu'on peut tenir sans manger ?
J'sais pas.
Mais combien de temps à ton avis ?
Peut-être quelques jours.
Et qu'est-ce qui arrive après ? On tombe mort d'un seul coup ?
Oui.
Et bien non. Ça prend longtemps. On a de l'eau. C'est le plus important. On ne tient pas très longtemps sans eau.
D'accord.
Mais tu ne me crois pas ?
J'sais pas.
Il ne la quittait pas des yeux. Debout dans la neige les mains dans les poches du veston rayé trop grand pour lui.
Tu crois que je te mens ?
Non.
Mais tu crois que je pourrais te mentir quand tu me demandes si on va mourir.
Oui.
D'accord. Je pourrais. Mais on ne va pas mourir.
D'accord. »
______________________________
Cormac McCarthy, La route (The Road), traduit de l'anglais (Etats-Unis) par François Hirsch, éd. de l'Olivier, 2008 (2006), 244 pages, 21 €.
Du même auteur : Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
16:28 Publié dans => Challenge 100 ans de littérature américaine | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : la route, cormac mccarthy, littérature américaine, anticipation, apocalypse
25/11/2009
Effacement – Percival Everett [2001]





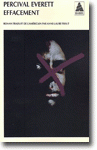 Thelonious Ellison – dit Monk – est un écrivain noir américain d'avant-garde dont les romans, très érudits, se vendent mal. Alors qu'il excelle dans la réécriture des Perses d'Eschyle, ou l'étude critique de Barthes, ce qu'attend de lui le monde de l'édition c'est un roman "black", une histoire de ghetto conforme au marketing du roman réaliste "identitaire" afro-américain. Ecœuré et révolté par la médiocrité et le succès de l'un de ces ouvrages dits de "littérature noire américaine", il en écrit, sous pseudonyme, une parodie. Résultat : la supercherie se transforme en best-seller ! Ecartelé entre une carrière universitaire végétante, une vie sentimentale au point mort, des crises familiales à répétition et un triomphe sous pseudonyme qu'il n'assume pas, Monk vacille et frôle la schizophrénie.
Thelonious Ellison – dit Monk – est un écrivain noir américain d'avant-garde dont les romans, très érudits, se vendent mal. Alors qu'il excelle dans la réécriture des Perses d'Eschyle, ou l'étude critique de Barthes, ce qu'attend de lui le monde de l'édition c'est un roman "black", une histoire de ghetto conforme au marketing du roman réaliste "identitaire" afro-américain. Ecœuré et révolté par la médiocrité et le succès de l'un de ces ouvrages dits de "littérature noire américaine", il en écrit, sous pseudonyme, une parodie. Résultat : la supercherie se transforme en best-seller ! Ecartelé entre une carrière universitaire végétante, une vie sentimentale au point mort, des crises familiales à répétition et un triomphe sous pseudonyme qu'il n'assume pas, Monk vacille et frôle la schizophrénie.
Ce roman est un pur bonheur, un vrai régal ! Découvrir la suite...
13:40 Publié dans => Challenge 100 ans de littérature américaine | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : effacement, pervival everett, littérature américaine, littérature contemporaine, écrivain, etats-unis
12/11/2009
Exit le fantôme – Philip Roth (2007)
 Nathan Zuckerman, le personnage principal de ce livre, est l'alter ego régulier de Philip Roth. On le retrouve dans nombre de ses romans, tantôt personnage central, tantôt second rôle. Dans tous les cas, il semble révéler les réflexions, les certitudes et les doutes de son créateur. Réflexions sur l'écriture, sur les relations complexes entre l'art et la vie, sur la place de l'écrivain dans la société, sur l'actualité, la politique et l'avenir de la société américaine...
Nathan Zuckerman, le personnage principal de ce livre, est l'alter ego régulier de Philip Roth. On le retrouve dans nombre de ses romans, tantôt personnage central, tantôt second rôle. Dans tous les cas, il semble révéler les réflexions, les certitudes et les doutes de son créateur. Réflexions sur l'écriture, sur les relations complexes entre l'art et la vie, sur la place de l'écrivain dans la société, sur l'actualité, la politique et l'avenir de la société américaine...
Nous retrouvons donc Nathan Zuckerman à 71 ans, toujours épatant d'intelligence, de lucidité et d'humour ironique, et désormais écrivain reconnu. Le voilà de retour à New York après onze ans d'exil volontaire dans les Berkshires (campagne du Massachusetts). Onze années vécues en solitaire et exclusivement consacrées à l'écriture et à la lecture. Onze années "hors la vie", coupé de tout et de tous. Si ce jour d'automne 2004 Nathan Zuckerman est de retour à New York, c'est poussé par la nécessité. Il revient pour subir une intervention susceptible d'améliorer son problème d'incontinence, à défaut de pouvoir régler l'autre conséquence pénible de son cancer de la prostate : l'impuissance. De retour au monde dont il s'était volontairement soustrait, le voilà obligé de se confronter à ce qu'il avait fui : les autres, et avec eux les rapports de force et le retour des affres du désir.
Dans la ville encore secouée par l'onde de choc des attentas du 11 septembre 2001 et accablée par la réélection inattendue de George W. Bush, trois rencontres vont occuper Nathan Zuckerman. Il y a d'abord Amy Bellette, ancienne compagne de son mentor, l'écrivain disparu E.I. Lonoff, aujourd'hui décatie et atteinte d'une tumeur au cerveau. Puis Richard Kliman, jeune arriviste insupportable qui a entrepris d'écrire une biographie de Lonoff alourdie d'un sordide secret, au grand dam de Zuckerman, pour qui l'entreprise reviendrait à laisser la vie du grand homme prendre le pas sur la postérité de son œuvre. Enfin, un jeune couple d'écrivains avec qui il envisage un échange de maisons. Et voilà Zuckerman, qui s'en croyait immunisé, en proie au désir fou pour Jamie, la très charmante jeune femme du couple. Et afin d'exorciser cette impossible liaison, il rédige, au grès de ses fantasmes, des dialogues de théâtre où Elle et Lui se donnent la réplique. Mise en abîme de l'écrivain qui ré-enchante son existence par la fiction.
Pour Philip Roth, Nathan Zuckerman est habituellement le dépositaire des séismes individuels provoqués par l'Histoire américaine. Ainsi ce roman aborde les conséquences psychologiques des attentats de 2001 et de la réélection de Bush fils. Cependant, dans Exit le fantôme, son principal sujet n'est pas là, mais est son héros lui-même et sa condition d'homme sur le déclin, en déroute tant physique qu'intellectuelle. Il aborde de façon tour à tour digne, mélancolique, rageuse ou moqueuse le problème du vieillissement et du cortège de maladies, de petites misères, de renoncements et d'humiliations qui l'accompagnent.
Dans ce roman, Philip Roth interroge aussi la fiction et la postérité littéraire en une charge contre le réductionnisme biographique. Par la révolte de Zuckerman devant l'opportunisme de Richard Kliman, Philip Roth dénonce le sort des artistes donnés en pâture contre leur gré à des biographes plus enclins à se faire un nom qu'à comprendre l'œuvre, à chercher un scandale vendeur qu'à respecter l'intimité de l'homme. Ainsi écrit-il : «Dès que l'on entre dans les simplifications idéologiques et dans le réductionnisme biographique du journalisme, l'essence de l'œuvre d'art disparaît».
Exit le fantôme est donc un roman très riche et profond, dont la multiplicité des interprétations possibles n'ôte rien à l'élégante simplicité et à la discrète sophistication.
_____________________________

 Philip Roth, Exit le fantôme (Exit Ghost), traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Claire Pasquier, éd. Gallimard, coll. Du monde entier, 2007 (2007), 326 pages, 21 €.
Philip Roth, Exit le fantôme (Exit Ghost), traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Claire Pasquier, éd. Gallimard, coll. Du monde entier, 2007 (2007), 326 pages, 21 €.
J'ai reçu ce livre dans le cadre de l'opération "Cadeau Test" de alapage.com, que je remercie pour cet envoi.
Du même auteur : La tache, Un homme & Indignation.
12:40 Publié dans => Challenge 100 ans de littérature américaine | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature américaine, littérature contemporaine, vieillesse, impuissance
























